Les actualités du TMLI
Tribune Aleteia de Laurent Landete
Tribune de Laurent Landete pour Aleteia
en lien avec le colloque organisé par le TMLI le 11 octobre 2025 : « S’engager en conscience »
« La formation de la conscience, enjeu de civilisation »
Avoir la capacité de décider ou d’agir « en son âme et conscience », selon l’expression consacrée, n’est pas inné. Pour que ce qu’il y a de plus intime en nous puisse devenir un guide sûr, il faut façonner la conscience, lui donner une forme. Cette formation passe par l’acquisition de connaissances et d’une culture permettant d’intégrer des repères et des principes pour bien vivre en société. Mais cela ne suffit pas. Former la conscience, c’est éveiller l’intelligence des situations, l’intelligence des relations, l’intelligence du cœur.
On perçoit vite le paradoxe qu’il y a à vouloir façonner de l’extérieur une faculté qui siège au plus profond de l’être. Comment alors se forger pour soi-même une conscience droite, capable d’un jugement libre et personnel ? Il faut une référence extérieure, non pas pour imposer ce qu’il faudrait penser ou choisir, mais pour offrir une lumière qui éclaire la route. Une lumière reçue, qui n’ôte rien à la liberté, mais qui lui donne sa force et sa rectitude. C’est à cette clarté qu’une conscience peut demeurer fidèle, même au prix de la contradiction, de la solitude ou de l’épreuve.
Former la conscience, c’est donc former l’intelligence dans la lumière d’une sagesse qui rend l’homme capable de juger avec justesse, de résister aux pressions et d’assumer la responsabilité ultime de ses choix devant Dieu et devant les hommes.
Accepter de former son intelligence à la lumière d’une sagesse véritable, c’est déjà consentir à un déplacement intérieur : l’homme se décentre de lui-même et s’arrache aux ténèbres d’une perception autocentrée où il se ferait la mesure de toute chose. Surgit alors aussitôt la question anthropologique par excellence : quelle est la place de l’homme dans l’univers ?
La révélation chrétienne répond avec une clarté saisissante : la mesure de l’homme dépasse l’homme. Plus encore, le seul qui puisse donner à l’humanité sa véritable mesure, c’est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Voilà ce que saint Jean-Paul II a magnifiquement rappelé dans son encyclique Redemptor hominis : parce que Dieu s’est fait homme, nous pouvons enfin comprendre notre vocation et notre place dans le cosmos. Le mystère de l’homme ne s’éclaire que dans le Verbe incarné. Dans sa première homélie place Saint-Pierre, ce pape venant d’un pays qui subissait le joug du totalitarisme communiste, ajoutait avec force : « Le Christ sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme ». Ainsi, la conscience humaine n’est droite que lorsqu’elle est illuminée par la présence du Sauveur.
Former les consciences suppose donc une intimité avec Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie : tel est l’itinéraire spirituel. Mais cet itinéraire s’accompagne d’une démarche intellectuelle, tout aussi intime, nourrie de la fréquentation des Écritures saintes et de la Tradition. Pour que cette sagesse éclaire véritablement, il faut consentir à demeurer dans sa lumière.
C’est précisément ce qui m’enthousiasme dans un lieu comme le Collège des Bernardins : rendre accessibles à tous la Bible, la théologie et la philosophie, et le faire à travers le dialogue. Dialogue, d’abord, entre le Verbe incarné et chaque homme ; dialogue aussi entre les hommes eux-mêmes, qui cherchent ensemble à répondre à cette Parole qui les appelle. Car Dieu est Logos, Parole par excellence, et il est naturel que la formation de l’intelligence à la lumière de la Révélation passe par l’échange des paroles humaines.
Or l’urgence d’une telle formation des intelligences se fait aujourd’hui sentir. Elle est remède à la crise de la raison que nous traversons. Cette crise n’est pas tant un risque pour le progrès scientifique qu’un péril pour notre capacité à vivre des relations apaisées. Car lorsque seules règnent les émotions subjectives, elles engendrent inévitablement la violence ; tandis que la confrontation d’opinions pesées, mûries par une réflexion personnelle, ouvre à la reconnaissance mutuelle : celle d’un autre capable d’exercer, comme moi, le jugement de sa propre conscience. Voilà le véritable enjeu de la formation des consciences : former l’intelligence à la lumière de la sagesse chrétienne, et cela, dans le dialogue.
Une telle ambition peut paraître décalée quand on voit le rythme de réactions, l’immédiateté des commentaires sur les réseaux sociaux, la polarité des jugements qui sont si vite des condamnations, la place que prennent les algorithmes. Mais je ne crois pas du tout qu’il faille nous considérer, avec cette ambition, comme un dernier village gaulois retranché derrière les fortifications de sa foi, de ses textes, de ses traditions. Cette sagesse est un trésor, précisément pour les hommes de ce temps, pour notre humanité telle qu’elle vit aujourd’hui, assoiffée, au fond, de relations humaines plus riches, plus vraies, plus paisibles. Elle est comme un patrimoine que nous avons reçu en héritage et que nous devons transmettre, sans rupture entre les générations. Et dans ce devoir de transmission, il me semble que la rencontre, l’échange, la curiosité de connaître et de comprendre l’autre, est déjà œuvre de formation de la conscience, dans la mesure où cette disposition à entrer en relation en vérité offre à l’autre l’espace pour se donner en vérité, et donc d’abord se connaître en vérité.
Il y a bien là un enjeu de civilisation, au sens d’une opération qui nous rend plus civilisé, autrement dit plus humain : dans ce dialogue entre les hommes, placé dans la lumière de la révélation divine se joue une forme d’accomplissement de notre humanité.




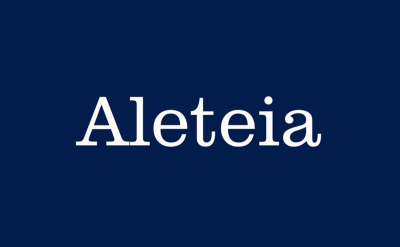
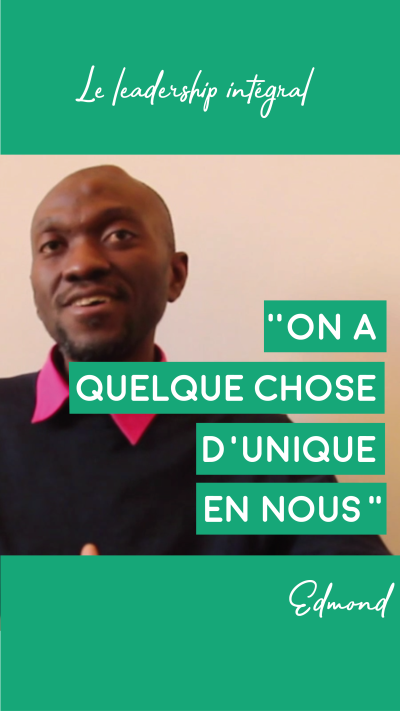



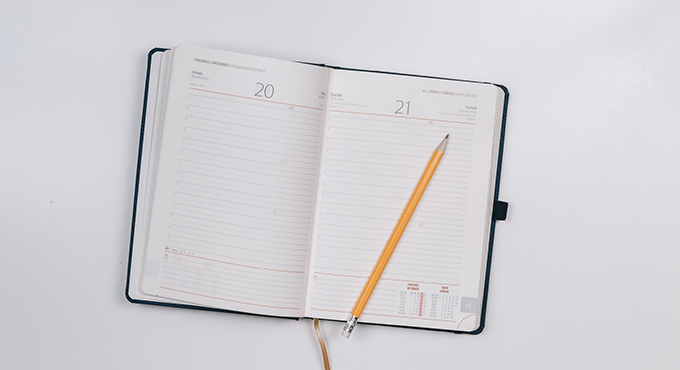
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.